Quand les livres sont une invitation à la marche #1
Un de mes grands rêves est de faire un long voyage à pieds. Pour retrouver le rythme de la marche. Eprouver physiquement les distances, les dénivelés, les paysages, les conditions climatiques. Prendre le temps de laisser mon esprit s’émerveiller, vagabonder, se déconnecter et se libérer de toutes pressions. La marche me permet de méditer, de retrouver l’essentiel, d’écouter ma petite voix et mon corps. Elle est en quelque sorte un besoin vital comme respirer ou manger. Alors, je marche. Parfois seule. Désormais, le plus souvent accompagnée de Sacha. Elle prend une autre dimension. Plus observatrice. Avec plus d’émerveillements et de discussions philosophiques. Avec aussi quelques moments de grâce où nous nous perdons chacun dans nos pensées et avançons en silence. Je nous prépare tout doucement à une longue marche, à ce long voyage rythmé par nos pas, le soleil et les rencontres. En attendant le grand départ, je me plonge dans les récits de grands marcheurs, rêve leurs aventures, recherche les raisons qui les ont poussés à partir à l’aventure et étudie leurs expériences. Au travers d’une sélection assez hétéroclite, entre romans, récits et essais, je vous invite à voyager aux côtés de ces marcheurs célèbres ou moins, sportifs ou érudits, novices ou aguerris ! Voici les trois premiers titres choisis pour cette série consacrée à la marche dans la littérature.
Marcher (ou l’art de mener une vie déréglée et poétique) de Tomas Espedal

Un beau jour, Tomas sort de chez lui et, poussé par une envie irrépressible, décidé de poursuivre son chemin. Laissant derrière lui son couple et sa maison, avec pour seule feuille de route l’envie et le rythme de ses pas, il s’embarque dans une promenade improvisée de plusieurs mois qui le conduit à travers la Norvège, au Pays de Galles, à Paris, à Istanbul et dans les montagnes de Transylvanie.
Au fil de son escapade physique et spirituelle, le narrateur itinérant puise ses forces dans les œuvres de nombreux écrivains marcheurs – Whitman, Rousseau, Kierkegaard, Hölderlin, Rimbaud, Lawrence, Thoreau, Chatwin… -, la littérature jouant pour lui le rôle d’indispensable carburant.
Roman dénué d’artifice, quête de plaisirs simples, Marcher est une hymne à la liberté, à la poésie et aux rencontres fortuites. Une vivifiante bouffée d’oxygène.
Rousseau n’est pas le premier à établir un lien entre la marche et la bonne pensée ; il est cependant le premier écrivain important à réfléchir à ce que marcher veut dire ; il attribue à la marche une valeur romantique : elle nous rend plus proches de la nature, de l’authentique ; elle nous fait tout de suite éprouver un bien-être, un pur sentiment de bonheur ; qui plus est, elle nous rend libres. Le marcheur connaît la liberté. Il peut choisir ses chemins. Et la marche à pied stimule la pensée et améliore la santé.
Marcher, faire halte, manger, penser, observer. Boire l’eau du ruisseau, remonter vers la neige, glisser pour ainsi dire à travers le haut plateau dans un tempo régulier, comme si les jambes marchaient toutes seules. Sans effort, avec fluidité, comme si les jambes gommaient le paysage, traçant une ligne horizontale qui avance tout droit. Cela ressemble à une ivresse, c’est peut-être une ivresse, celle du corps, qui fait disparaître la fatigue et les côtes escarpées, chasse les soucis et les douleurs, les ampoules, les courbatures, le poids du sac, je ne ressens rien de tout ça, pas avant de m’arrêter, une brève halte, puis je continue. Il arrive un moment, un stade où la marche vous fait franchir une limite sensible ; on n’a plus envie de s’arrêter, je veux seulement continuer de marcher, marcher, marcher, peu importe où et pourquoi, peu importe dans quelle direction, la marche est devenue une seconde nature, une ivresse, une liberté qui grise, tu peux aller où tu veux, aussi loin que tu veux, tu iras peut-être si loin qu’il te sera difficile de revenir à une vie normale, à ce qui existait autrefois, un travail, une maison. On marche vers quelque chose de nouveau. Au bout d’un moment, on a le sentiment d’être parti pour une longue pérégrination. Pourquoi l’interrompre, pourquoi ne pas continuer ? Vers quoi ? Vers qui ? Vers où ? Nous n’en savons rien. Nous marchons.
Celui qui a marché loin sait pourtant à quel point la compagnie peut s’avérer indispensable. Sans compagnon de route je ne serais jamais venu à bout de certains trajets particulièrement ardus. On ne traverse pas la Turquie tout seul. Et si on le fait, on se sent perpétuellement exposé, on n’est jamais en sécurité ; on perd la sensation de liberté en marchant seul. On dépense beaucoup de temps et d’énergie à chercher des endroits sûrs, des endroits où on peut se détendre et se reposer. Un endroit sûr où dormir. On devient méfiant, suspicieux, on est continuellement sur ses gardes. On évite certains lieux, certaines maisons, on change d’itinéraire, on prend des précautions, on est limité par la peur. Quand on est deux, il est plus facile de dormir à la belle étoile ; dans la journée, on marche chacun de son côté, seuls, mais ensemble ; on croise des chiens errants, des étrangers, mais avec une assurance que, seul, on n’a pas.
Oui, pourquoi marcher quand on peut naviguer ? Pourquoi marcher quand on peut se déplacer en voiture ou en avion ? Pourquoi cette lenteur, cette solitude, tous ces efforts, tous ces désagréments, pourquoi cette révolte imperceptible, cette protestation inaudible, cette tentative de faire quelque chose de différent et de compliqué ? J’ai toujours voulu vivre différemment, mener une autre existence que celle à laquelle on m’a éduqué. Depuis tout petit, je répugne à faire ce qu’on me dit de faire. J’ai toujours cherché à me compliquer les choses. Jamais à les simplifier, à les rendre plus faciles, toujours à les rendre plus dures, à les mettre hors de portée.
Mais les meilleures cartes, on ne peut les acheter ; elles sont dessinées par les gens que l’on croise sur la route. Et les gens que l’on croise sur la route sont à la fois bienveillants et précis. C’est vrai dans tous les pays. Les meilleures cartes sont transmises oralement et avec des gestes, parfois à l’aide d’un stylo et un bout de papier.
Le mal du pays. Il est inhérent à tout voyage, nous sommes épuisés, nous voulons rentrer ; le mal du pays croît, se renforce, se ramifie dans toutes les parties du corps ; les pieds veulent rentrer, les mains, le cœur, les pensées veulent rentrer. Nous en avons assez ; assez vu, assez entendu, vécu plus que nous ne pouvons supporter, et le mal du pays se répand dans le corps tel une paresseuse indifférence, une hébétude faisant obstacle à tout nouveau départ, à tout nouveau changement, aux nouvelles rencontres, aux nouveaux lieux. Le voyage du retour a déjà commencé, nous pensons au retour et nous rentrons par la pensée, même s’il nous reste de la route à faire ; nous ne sommes pas encore à mi-chemin, mais notre trajet semble avoir légèrement fléchi, il a franchi un cap et changé de direction ; lentement, discrètement, il repart en sens inverse. Le voyage du retour ne s’inscrit pas sur la carte, il démarre dans le corps, se propage à la tête, gagne les pieds ; maintenant nous retournons à la maison. Nous nous transformons en une sorte de somnambules, nous marchons dans un demi-sommeil, à régime ralenti, nous nous traînons de mauvaise volonté, avec moins de forces et un puissant désir de nous reposer ; de rentrer chez nous et dans dormir dans un lit confortable et familier. Le mal du pays surgit brusquement, il disparaît tout aussi brusquement, comme lorsqu’on grimpe une côte escarpée ; nous commençons à être fatigués, nous avons envie d’abandonner, de redescendre, de retourner dans le lit que nous venons de quitter, mais par un pur effort de volonté nous continuons de monter, nous atteignons le sommet et nous reprenons haleine devant la vue splendide du lieu que nous allons découvrir : un nouveau lieu enchanteur.
Marcher (ou l’art de mener une vie déréglée et poétique), Tomas Espedal, Babel
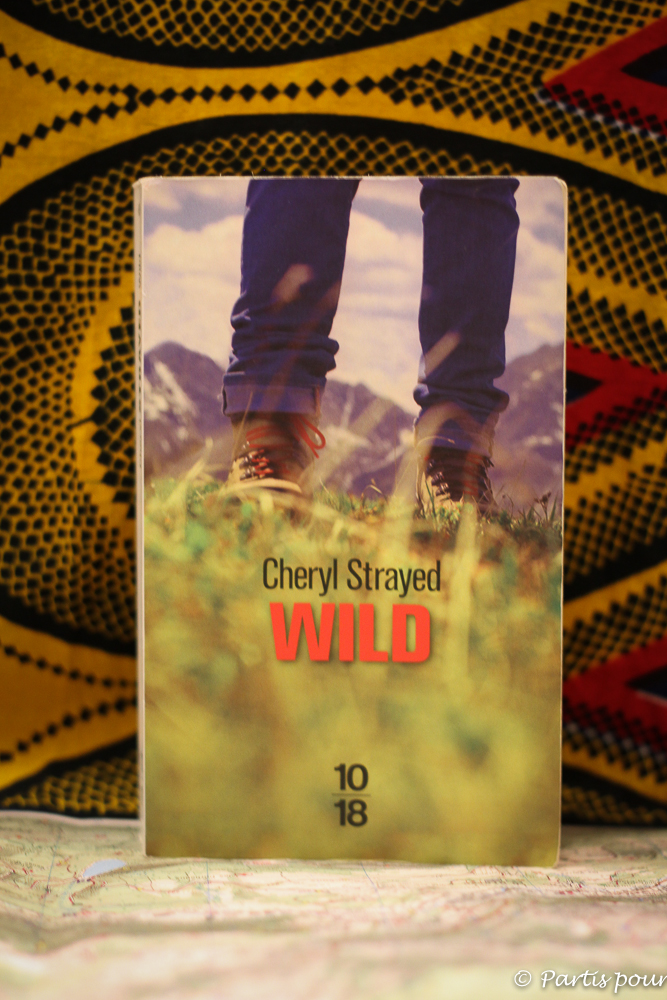
Wild de Cheryl Strayed
Il est de ces livres qui vous font beaucoup de bien et vous donnent envie de partir à l’aventure dès la dernière page tournée. Ce roman autobiographique de Cheryl Strayed, Wild, en fait partie. Il n’est sûrement plus nécessaire de vous le présenter tant il a eu du succès, notamment lors de la sortie du film en janvier 2015 avec en rôle principal Reese Witherspoon. Toutefois, pour ceux qui seraient passés à côté, voici un bref résumé de l’histoire : suite à une longue et lente descente aux enfers liée à la disparition prématurée de sa mère, Cheryl décide de reprendre sa vie en mains et de partir seule sur le Pacific Crest Trail alors qu’elle n’a aucune expérience de la montagne ni de la marche. Sur près de 1700 km, elle nous emmène à la découverte de ces paysages époustouflants de Californie, d’Oregon et de Washington, traversant déserts, montagnes, forêts, parcs naturels et routes nationales, et sur le chemin de la réconciliation et de l’expiation. Au fur et à mesure, on découvre par petites touches son histoire et les raisons qui l’ont poussée à se lancer dans cette folle aventure.
Bien que généralement je préfère lire le livre avant d’aller voir le film, j’ai dérogé à ce principe dans ce cas-ci. Nous étions allés voir le film à sa sortie. J’avais besoin de grands espaces et d’un peu de légèreté. Mes attentes ont été largement rencontrées. J’ai eu alors envie de me plonger dans le roman pour faire durer le plaisir. Comme le film, le roman est plein de bons sentiments, d’émotions, agréable et fluide. Un vrai roman américain qui fait du bien. Un roman avec lequel on rit, on pleure, on respire et on souffre. Un roman dans lequel on embarque sans se poser de questions et qu’on ne quitte qu’une fois arrivé à la fin. Facilement. Et j’aime beaucoup qu’on me raconte de belles histoires sans trop se prendre la tête même si parfois c’est assez caricatural. D’ailleurs, Cheryl Strayed est tout le contraire de Tomas Espedal qui lorsqu’il part n’emporte que le strict minimum alors qu’elle se trouve affublée d’un sac énorme, bien trop rempli de choses inutiles ou incongrues et bien trop lourd. Et puis, malgré ses douleurs, ses peurs, ses pieds en sang, la faim et la soif, ses nombreux moments de solitude, ses rencontres peu avenantes, la chaleur ou le froid, la monotonie et l’épuisement, elle m’a donné envie de mettre mon sac sur le dos et de partir fouler le sentier de ce fameux PCT. Pour m’émerveiller devant la beauté des paysages grandioses, pour m’éprouver aussi, retrouver la simplicité qu’impose la marche, me connecter à la nature et me déconnecter, pour être fière de moi. Un roman, comme une bouffée d’air frais, comme un voyage dans les terres sauvages américaines avec une amie. Un livre à emporter dans ses valises ou, mieux encore, dans son sac dans le métro pour prolonger les vacances.
Wild, Cheryl Strayed, 10/18
Sauvage par nature, Sarah Marquis
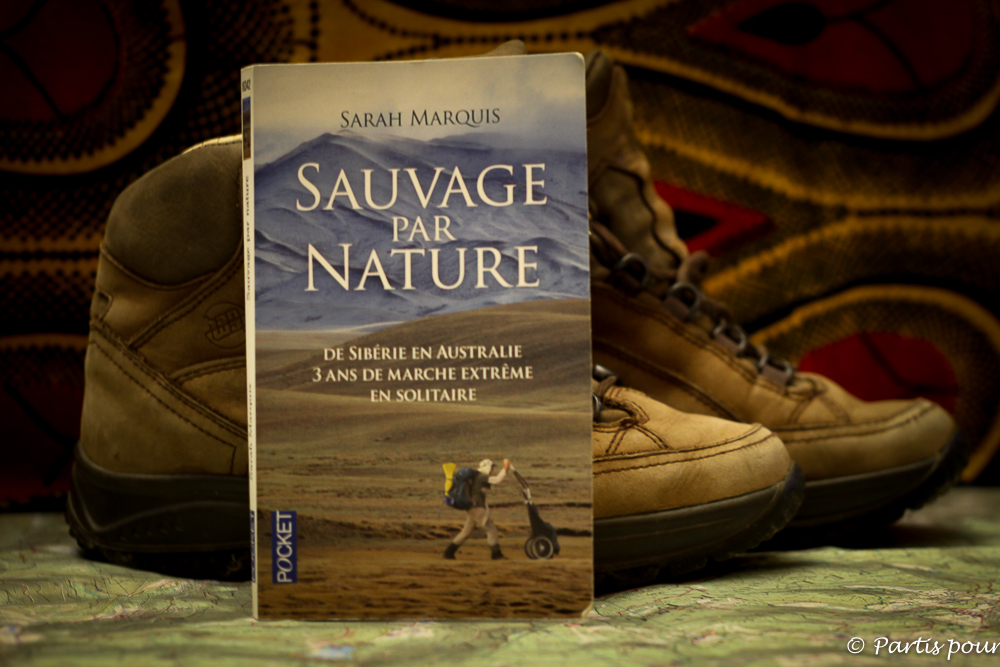
Dans la même veine de titre que le précédent mais avec un personnage féminin aux antipodes, une aventurière aguerrie, une femme forte et expérimentée, je vous présente Sauvage par nature. De Sibérie en Australie. 3 ans de marche extrême en solitaire de Sarah Marquis. Sarah Marquis est une des rares grandes aventurières de ce siècle, une femme qui ne fait pas dans la demi-mesure, entière et absolue, sauvage et intuitive. Elle ne joue aucun jeu et ne se la raconte pas. Elle est ! J’ai une grande admiration pour cette femme qui ne s’encombre pas du superflu. Elle m’impressionne par sa volonté, sa capacité d’adaptation, son intelligence, sa compréhension et sa connaissance de son environnement. Une femme à la hauteur des Ella Maillart, Alexandra David-Néel, Isabelle Eberhardt ou encore Odette de Puigaudeau.
Mais revenons-en au récit. Pendant 3 ans, l’auteure traverse à pieds et seule les contrées parmi les plus inhospitalières de la planète dans des conditions climatiques extrêmes. Steppes sibériennes et mongoles, désert de Gobi, jungle laotienne, bush australien, montagnes du Sichuan… Elle doit se protéger des bêtes sauvages mais aussi, et bien plus souvent encore, des hommes, des orages, du froid, de la pluie et du soleil. Pas de répit ! Sa démarche n’est pas d’aller à la rencontre de l’Autre, de partager avec les populations locales mais d’éprouver l’intense solitude et de s’unir à la nature. Retrouver l’intuition, écouter son corps et son environnement. Éprouver sa condition d’humain dans la suprême nature. Être en harmonie. Lorsque je lis les critiques, beaucoup le lui ont reproché ce manque de chaleur humaine. Mais est-ce un impératif d’aller à la rencontre de l’Autre lorsque l’on voyage ? J’ai l’impression qu’il est actuellement de bon ton de dire que l’on part pour rencontrer les peuples et apprendre de l’Autre. Mais chaque voyageur a une approche différente et chaque voyage offre ou non son lot de rencontres. Voyager n’implique pas obligatoirement d’aller vers l’Autre. De plus, l’autre cela peut aussi être la mère Nature, les animaux ou encore soi-même. Il me semble également inutile de forcer les rencontres car celles-ci peuvent se faire tout naturellement, au hasard, au détour d’un chemin ; sauf si bien évidemment le but de votre voyage est justement de partager des moments et de découvrir des nouvelles coutumes et cultures. Sa solitude, sa façon d’éviter au maximum les rencontres, de se protéger, ne m’ont pas du tout dérangée. Au contraire, j’y ai vu une forme de sagesse. Elles font partie de sa marche.
Son expédition est un exploit et elle ne le doit qu’à sa volonté, sa force de caractère et son instinct. Elle force mon admiration tout en montrant ses failles et ses faiblesses sans s’appesantir. Dans le réalisme de sa situation. Loin de l’image marketing et des réseaux sociaux, elle montre que la vraie aventure existe encore. Qu’il faut de la folie mais une grande maîtrise, de la conscience dans l’inconscience. J’ai aimé ce récit. J’ai voyagé avec elle. J’ai eu froid, j’ai eu soif, j’ai eu peur, j’ai eu mal et j’ai été émue par ce que la nature peut offrir comme moments magiques, comme lorsqu’elle rencontre des loups ou un léopard des neiges. Ce récit m’a fait réfléchir à mon rapport au monde, au voyage et à la nature. Me rendant compte que je n’étais pas assez connectée à l’essentiel, pas assez à l’écoute de toutes ces petites voix qui nous parlent mais que nous n’entendons plus, que j’étais loin de mes rêves d’aventures absolues… Alors, suite à cette lecture, j’ai eu envie de revoir ma façon de voyager et de m’inscrire davantage dans des projets plus ambitieux. Je ne pourrais jamais faire le même type d’expérience que Sarah Marquis. Je le sais. Mais, être plus en accord avec mes rêves, je le peux. J’ai appris aussi comment changer ma perception du monde et mon rapport à notre environnement en utilisant mes sens et en écoutant mes intuitions. Tout en retenant que nos seules limites sont mentales.
Je vous conseille ce récit d’une femme qui va au bout d’elle-même, cette aventure extrême et extraordinaire. Et puis, argument de plus, Sarah Marquis a reçu le prix européen de l’Aventurier de l’année 2013.
Je n’avais pas cherché à lire le terrain tel qu’il était sous mes yeux… Malgré mon expérience, ce jour-là, je n’ai pas ouvert mon esprit, je l’ai envoyé sur une piste qui était basée sur une réflexion, une théorie, une tergiversation sortie tout droit de ma tête. Et pourtant, n’aurais-je pas pu ressentir le léger changement de température que la présence de l’eau provoque ?
Le mur de pierre créait alors un vrai obstacle. Et le vent, à lui seul, camouflait le bruit de l’eau.
La sensibilité est l’unique réponse pour comprendre un paysage. Il faut laisser de côté la logique, les théories, le bon sens et tout le reste. Les blocages de l’esprit sont comme des barrières imaginaires que nous nous créons et qui nous empêchent de voir.
Ne jamais donner d’importance aux gens ou animaux dont vous ne désirez pas attirer l’attention. Ignorer est la meilleure des solutions. Ne pas lancer de regard franc, pour ne pas provoquer, mais ne laisser aucune chance à l’autre de poser le regard sur vous trop longtemps. Ne pas vous laisser déshabiller du regard, cela donne un certain pouvoir à l’autre. Un juste milieu est nécessaire, une attitude posée qui dégage une force tranquille. Avoir peur ne vous sert en aucune circonstance, donc retirez déjà cette émotion de votre catalogue. Ne pas confondre avec la vraie peur, que nous allons rencontrer plus loin…
Souvent l’idée de changement est plus pénible que le changement en lui-même.
On me demande souvent à quoi je pense quand je marche. Eh bien, je ne pense pas, je vis ! Il y a des moments pour la réflexion et d’autres pour le mouvement.
Le mouvement est salvateur, il remet tout en question. Tout ce qui nous entoure, vit, respire, bouge, nous humains inclus. Rien n’est comme on se l’imagine, constant. Tout évolue à chaque seconde.
Mes journées sont désormais pénibles psychologiquement, je me cache, je dors sous les ponts. Les enfants me jettent des pierres à chaque fois que je traverse un village. Je suis triste, tout ici est dépourvu de cette énergie de vie… Je découvre des cultures faites dans des décharges, ici tout est pollué à l’extrême. La terre est épuisée, les cours d’eau sont des décharges à ciel ouvert. Des résidus chimiques créent un filtre violacé à sa surface. Des plantations en tout genre sont accélérées à l’aide d’éclairages de nuit, qui trompent ainsi le cycle de la plante qui continue à pousser. Je suis dans un autre monde. Les scènes de vie me crèvent le cœur. Les animaux sont menés vivants au marché pour leur viande. Il est courant de voir de grosses chèvres noires vivantes pliées en deux sur une moto, de chaque côté du porte-bagages, retenues avec des cordes, qui leur rentrent dans la chair à vif. Des coqs sont suspendus tête en bas sur les sacs à l’arrière… Et juste sous le porte-bagages, dans un sac de riz, un chien hurle chaque fois que le conducteur passe une bosse car il se fait écraser entre la roue et le porte-bagages… La liste des cruautés envers les animaux est encore longue. Les cris de douleur de ces animaux à l’agonie me hantent encore… C’étaient des cris de désespoir !
Je suis en état de choc à chaque fois qu’un de ces convois me dépasse… Cette Chine m’a marquée au fer rouge, elle m’a repositionnée en tant qu’utilisatrice de cette planète. Je ne suis plus la même, j’ai vu de mes yeux, j’ai senti, j’ai pleuré devant cette misère humaine et animale.
Ensuite je m’enfoncerai comme une bête sauvage dans la forêt, là où je me sais en sécurité.
Bouleaux et épicéas se partagent le terrain avec mouches, moustiques et autres spécimens volants non identifiés qui me poursuivent en nuages. L’intensité que la taïga dégage est palpable et en totale contradiction avec les habitants de cette région du monde. Le sud de la Sibérie semble se décomposer comme un champignon au ralenti. Les carcasses cubiques de béton en tout genre de l’époque soviétique sont toujours là, nues comme des squelettes.
Il règne ici une énergie qui dévore celui qui n’a pas compris que chaque instant est survie…
Je remarque que dans mon langage intérieur je m’approprie les choses, sans doute pour me les rendre plus familières. Par exemple, lorsque je parle du bush, je dis souvent ‘mon bush’. Parce que pour moi, c’est là où je suis bien, c’est chez moi. Je n’ai pas besoin de matériel, de maison. Mais j’ai besoin du bush. Ces sons, ces odeurs sont en moi, tout le temps, même quand je n’y suis pas. Et m’y retrouver est un bonheur à chaque fois décuplé même avec mon corps fatigué et les températures extrêmes. Je n’échangerais ma place avec celle de personne.
Je me rends dans un shop que je connais bien, qui se trouve au 900 Hay Street. On n’y vend que des cartes topographiques. J’en sors le sourire aux lèvres, mes cartes sous le bras, je vais déjà mieux.
Au travers de cette première sélection, je vous ai proposé des titres et des personnalités bien différentes mais dont le point commun est d’offrir une réflexion sur la marche, sur son effet thérapeutique, sur la nécessité de marcher pour s’harmoniser, se connecter et se recentrer. Marcher pour se retrouver. Marcher pour libérer sa créativité. Marcher parce qu’il n’y a, au fond, que ça à faire. J’ai apprécié ces trois lectures et j’espère qu’elles vous plairont également. Alors, rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle sélection tout aussi hétéroclite… N’est-ce pas là le bonheur de la lecture ?
Si vous avez des titres à me conseiller ou que vous souhaitez partager, n’hésitez pas à me laisser un commentaire.
Et si vous êtes intéressé par un de ces récits/romans/dvd, sachez qu’en l’achetant via ces liens affiliés, vous nous permettrez de toucher une petite commission et ainsi de poursuivre notre aventure et d’assurer le maintien de ce blog.
Articles liés
Quand les livres sont une invitation à la marche #4
Comme nos déplacements sont à présent limités, j’ai choisi de partager quatre lectures qui sont une porte vers l’évasion, l’aventure, la vraie vie telle que je l’entends et le mouvement. J’aime la marche. J’aime ce rythme lent qui permet de retrouver une...
Lectures maliennes
Je voulais partager mes lectures maliennes depuis bien longtemps… Depuis l’époque où nous avions passé un peu de temps à Bamako et où nous envisagions de nous y installer pour quelques mois, voire une année. Et puis, la vie nous joue des tours. Les...
L’histoire de Chronique d’un départ
En mai 2010, assis sur les remparts de Saint-Malo, en pleines rêveries et discussions suscitées par nos diverses rencontres au Festival des Étonnants Voyageurs, nous décidions de changer de vie et de prendre la route. Plus encore, devenir...






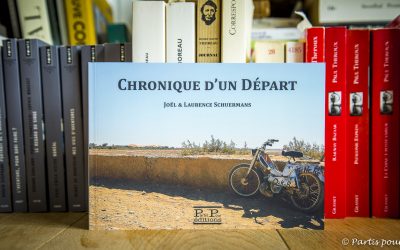
Le temps passe et mon regard sur mes lectures évoluent. J’étais sortie de Wild avec la très forte envie de partir marcher (j’ai abandonné l’idée de marcher depuis que je suis maman). Mais il manquait quelque chose, alors je n’ai pas gardé ce livre. Trois ans plus tard, je le regrette, car j’aimerai le relire. Je me souviens de la force de l’auteur alors qu’elle n’était pas prête à vivre une telle aventure.
Par contre j’avais un souvenir mitigé du récit de Tomas Espedal. Aujourd’hui le récit s’est tellement estompé que je ne garde qu’une impression négative, avec beaucoup de bières et de références littéraires.
Il ne me reste que le 3e titre à lire. Je n’avais jamais entendu parler de Sarah Maquis, mais tu donnes envie, surtout la toute dernière citation.
Tiphanya Articles récents…Efteling, son premier parc dâattractions
Effectivement, il y a pas mal de bières et de références littéraires dans le roman d’Espedal. Cela ne m’a pas gênée pour ma part. Alors si j’ai adoré la première partie du livre, c’est à ce moment-là que je t’en avais parlé. Puis, j’ai commencé la deuxième partie et j’ai perdu le souffle de l’ouvrage… Peut-être lassée… Mais j’aimais quand même ses réflexions sur la marche. Aussi, je donne mon avis sur ses lectures souvent bien longtemps après les avoir lues. Sarah Marquis est une grande aventurière et elle offre des réflexions très intéressantes aussi.